Nous allions devisant côte à côte, lui le champion, moi l’ordinaire. La conversation commençait à tourner court. Le souffle que je dépensais pourtant à mots comptés ne m’était pas intégralement rendu, et chaque tour de pédale creusait ma dette. Je m’apprêtais à le lui dire quand ça s’est produit.La veille au soir, il avait tourné la tête vers moi et, sans penser à mal, m’avait proposé cette folie, « veux-tu venir rouler avec moi demain », ajoutant que « trois heures de rase campagne, quelle meilleure occasion de bavarder librement ? » Sur l’instant, j’avais senti une sorte de crampe au niveau des sourcils – mon visage s’était immobilisé en pleine course, façon un-deux-trois-soleil – et une goutte de sueur acide dévaler mon dos, qui a dû y laisser une cicatrice. Pour vérifier, il faudrait que je sois capable de me déhancher devant un miroir, comme le font les beautés callipyges des réseaux sociaux, ce qui ne m’est toujours pas redevenu possible depuis lors. Pris de court, j’avais un peu protesté, balbutiant de mon manque d’entraînement, de mes écarts alimentaires, de mon âge, que sais-je… Mais il avait promis sa clémence, et j’avais accepté.
Je dois dire aussi avant le reste que je m’étais senti plutôt flatté. Une sortie, seul à seul, avec François-Xavier Berzingue (soit un athlète de classe internationale, un des meilleurs du monde en montagne), ça ne se refusait pas. Berzingue était rien de moins qu’un vrai champion, un de ces monstres physiologiques que sont les spécialistes du Tour de France. Quant à moi, j’avais été, certes vingt ans plus tôt, un bon petit coureur, assez costaud et à peu près compétent. Il était loin de toute compétition et comptait sur moi pour l’accompagner le temps d’une sortie détendue. N’empêche, je me faisais l’effet d’un honnête musicien de bal que Miles Davis inviterait à une jam session. J’étais donc heureux de la proposition, et curieux de la conversation qui se profilait, mais un peu inquiet de mon coup de pédale. Je craignais de souffrir et d’être ridicule, je ne sais pas dans quel ordre.Le matin même, après un dîner éternisé et une mauvaise nuit, j’étais parti à sa rencontre sous le crachin d’octobre. Quand il pleut, les premières minutes de vélo sont toujours désagréables ; c’est le bas du dos et la raie des fesses qui se mouillent les premiers.
J’allais, les épaules crispées, sur le suint luisant du bitume détrempé. Dans les virages et les ronds-points, j’avais l’impression d’avoir enfilé avec mon maillot le cintre dont je l’avais décroché. Pour ne rien arranger, je pédalais en maugréant, occupé à ressasser les petites impasses de mon quotidien. Ça durait depuis plusieurs mois. Chaque fois que je me retrouvais au guidon, au lieu de me laisser gentiment défroisser la face par le vent, je remâchais comme dans l’espoir de pouvoir enfin les avaler ces agacements déjà minéralisés. En général, j’en avais pour une heure. Là, je comptais sur la compagnie du cador pour que s’évapore ma bile.
D’ailleurs, la magie a opéré aussitôt que je l’ai vu. Je suis obsédé par cette étrangeté des corps spécialisés, qui ne s’harmonisent au monde que dans la production d’un geste unique, précis – isolé ; qui le reste du temps, c’est-à-dire la plupart du temps, semblent frangés d’une aura qui les désajuste aux choses et aux décors. En civil le soir précédent, vêtu dans une manière d’austérité probablement très calculée d’un pull crème ras-de-cou et d’un pantalon laissant voir ses chevilles nues, Berzingue m’était apparu dans la disproportion lévrière de ses membres fins et de son tronc volumineux quoique inencombré de muscles. Mais qu’il absorbe cette fine machine à deux roues et c’est la métamorphose. Alors, ses longs segments déliés n’évoquent plus aucune gracilité, mais une densité extraordinaire.
Déjà nous remontions une longue côte – j’étais allé le ctout en bas, sur les quais. Du bout de l’index, il faisait nonchalamment défiler les infos sur le petit écran fixé à son guidon. Ses pieds et son pédalier tournaient de leur côté, tels des êtres autonomes, et moi, plié en deux sur le petit boudin de gras qui me ceignait le ventre, je me sentais creux comme un mauvais légume. Il traçait un sillon précis sur la chaussée, à laquelle seshes d’eau sale ; je me tortillais sur ma selle en m’essuyant le nez tous les cent mètres. Ce surgissement d’une créature nouvelle me fascinait. Je m’affairais déjà à creuser à petites pelletées de fièvre le motif littéraire de cette transformation. Je délirais. C’est la parole qui retourne à la chair ! me disais-je sans crainte du ridicule, le verbe qui s’invagine et la puissance qui éclate.Jusqu’où le raccourcissement progressif de mon souffle m’aurait-il permis de poursuivre sur cette voie ? Je ne le saurai jamais. Je m’apprêtais, ai-je dit, à interpeller Berzingue – « Vas-y, baisse un peu l’allure, je ne passerai pas la journée à ce train-là » –, quand un grand fracas d’obscurité s’est abattu sur le monde. Brutal, mais bref. Je ne suis pas, contrairement à saint Paul sur le chemin de Damas, resté aveugle trois jours, et le Christ ne s’est pas adressé à moi. Ni personne. Juste quelque chose comme la nuit qui tomberait avec le poids d’une caisse à outils. Mais c’était moi. Quoi, ce bruit de clés à molette et de boulons, ma carcasse jetée au sol ? Non ? Si, car presque aussitôt les choses sont réapparues, à leur façon calme. Personnellement, je n’étais d’ailleurs pas moins calme. J’étais au bord de la route, à l’orée du bois. D’un mélange spongieux de feuilles mortes, de papiers décolorés et d’opercules de pots de yaourt émergeait un grillage auquel mon vélo était pendu par le guidon, le cou tordu. Un peu plus loin, les arbres, les seuls êtres qui, humains mis à part, se piquent de verticalité, étaient encore debout. Mais moi, j’étais couché, sur le flanc. Le monde m’avait sauté au visage et imposé ce repos dont la bipédie nous a privés il y a si longtemps. Ne passons-nous pas notre temps à chuter dans nos corps, indéfiniment ?
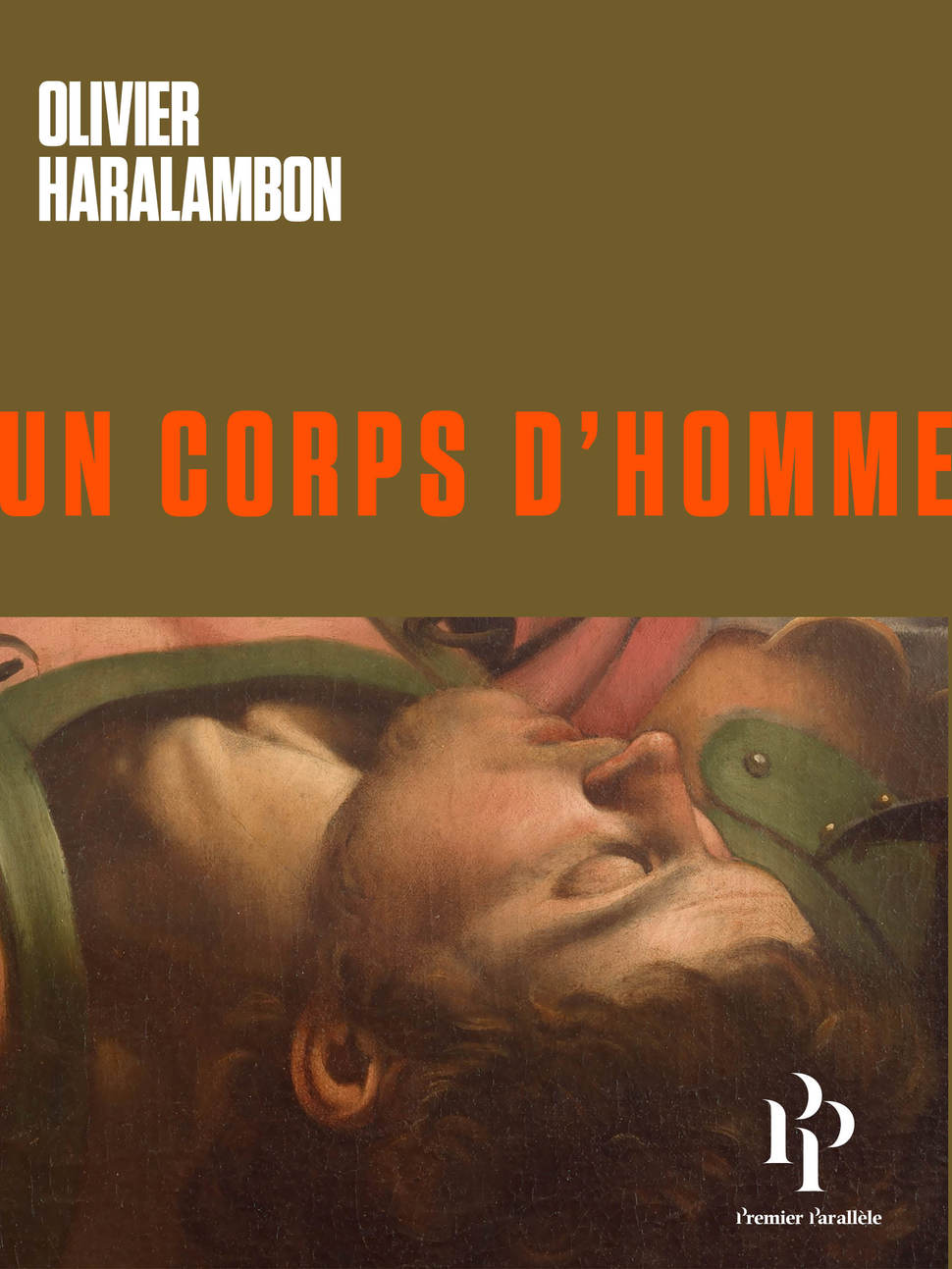








Premier Parallèle
Retrouvez-nous sur